La finance à l’ère de l’intelligence artificielle
Le secteur financier traverse une transformation majeure liée à la diffusion rapide des outils d’intelligence artificielle (IA), et en particulier de l’IA générative. Si les révolutions technologiques précédentes, l’informatisation et l’émergence de la finance quantitative dans les années 1970, ont déjà remodelé le secteur, l’IA se distingue par son autonomie, sa capacité à interagir en langage naturel et son aptitude à apprendre et s’adapter. Ces caractéristiques laissent présager une adoption très large et des effets potentiellement disruptifs sur l’ensemble des activités financières.
Opportunités et usages : des données massives aux décisions financières
L’IA permet de traiter et d’analyser en temps réel d’immenses volumes de données, incluant désormais des sources non structurées (news, communication d’entreprises, réseaux sociaux, données satellitaires etc.). Les outils de traitement du langage naturel et les grands modèles de langage (LLMs) convertissent rapidement l’information textuelle en signaux exploitables pour la prise de décision : conception de stratégies d’investissement, scoring de crédit, prédiction des mouvements de marché ou estimation des coûts de transaction. L’automatisation des tâches répétitives (suivi des transactions, détection de fraude, conformité) accroît l’efficacité opérationnelle et libère du temps pour des activités à plus forte valeur ajoutée. L’IA favorise aussi la personnalisation des services, améliorant l’expérience client et l’inclusion financière. En finance durable, elle facilite l’évaluation des risques climatiques et le suivi d’indicateurs environnementaux via l’analyse de données satellitaires ou textuelles.
Risques et limites : les angles morts de l’IA
Cependant, l’intégration de l’IA soulève des risques nouveaux et spécifiques. Les algorithmes peuvent être biaisés, conduisant à des décisions discriminatoires ; leur opacité rend l’explicabilité et la supervision difficiles. Même dépourvus d’intention, les systèmes peuvent poursuivre des objectifs non alignés avec ceux des humains, ou dévoiler des capacités et des comportements inattendus. Sur les marchés, l’usage massif de l’IA pour le trading peut provoquer des surréactions aux informations à court terme, accroître la volatilité, générer des comportements synchronisés et amplifier le risque systémique. L’exploitation de données alternatives, notamment issues des médias sociaux, expose également au risque de manipulation de l’information. L’adoption d’algorithmes d’apprentissage par renforcement peut favoriser des stratégies de collusion tacite ou manipulatives, posant des enjeux éthiques et juridiques majeurs.
Enjeux structurels et de gouvernance : une finance à deux vitesses ?
Le déploiement de l’IA risque d’accentuer les inégalités entre institutions : seuls ceux disposant de ressources computationnelles et de données massives pourront tirer pleinement parti des technologies, renforçant potentiellement les positions dominantes. Le marché de l’IA est concentré autour de grands acteurs technologiques, ce qui rend le système financier vulnérable aux défaillances techniques et soulève des questions de souveraineté des données. Par ailleurs, l’essor de l’IA soulève des implications économiques, sociales et environnementales : concurrence pour les financements (au détriment, par exemple, de la transition climatique), consommation énergétique et en eau des centres de données, et risques de pertes d’emploi liés à l’automatisation. Ces enjeux rendent nécessaire l’élaboration de modèles de collaboration homme machine, la promotion d’une IA « frugale » et des politiques publiques pour accompagner les transitions.
Supervision et régulation : encadrer sans brider, le défi règlementaire
Pour limiter les risques et préserver les bénéfices, il est essentiel d’adapter les cadres de régulation et de supervision. Les règles existantes sont appliquées de manière technologiquement neutre, avec des dispositifs spécifiques pour les systèmes d’IA à haut risque. L’AI Act européen, entré en vigueur en août 2024, illustre cette logique en imposant des exigences différenciées selon les niveaux de risque, notamment pour les LLMs. La coordination internationale, la transparence des modèles, la responsabilité des acteurs et la protection des investisseurs figurent parmi les priorités. Les autorités, en particulier les banques centrales et les superviseurs financiers, devront repenser leurs outils pour surveiller les risques systémiques nouveaux et garantir la stabilité financière.
Conclusion : des opportunités sous conditions
L’intelligence artificielle offre des opportunités substantielles pour améliorer l’efficience, la personnalisation et la résilience du système financier, tout en posant des défis significatifs en matière d’éthique, de stabilité, d’inégalités et d’impact environnemental. Maximiser les bénéfices sociétaux de l’IA exige des pratiques responsables dès la conception, des régulations adaptées et coordonnées, des instruments de supervision renouvelés et des recherches approfondies. Ce numéro apporte une synthèse précieuse des débats actuels et vise à éclairer réflexions et actions futures pour maîtriser les enjeux complexes de l’IA en finance.
Pour aller plus loin :
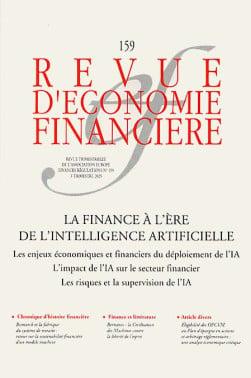
©Revue d'économie financière
Revue d'économie financière, 3e trimestre 2025 N°159
La finance à l'ère de l'intelligence artificielle
Ce numéro réunit treize articles structurés en trois parties : enjeux économiques et financiers du déploiement de l’IA ; impact de l’IA sur le secteur financier ; risques et supervision.
Les contributions couvrent des thèmes variés : besoins de financement et enjeux éthiques (C. Villani), effets sur productivité et innovation et la nécessité d’une politique industrielle pour l’IA (P. Aghion), mesures de diffusion de l’IA via l’analyse des brevets (A. Bergeaud), rôle des banques centrales et des DLT (A. Benassy Quéré & D. Zhang). D’autres articles analysent les applications opérationnelles et les gains attendus (J.-P. Mazoyer & X. Boileau), l’importance centrale des données (C. A. Lehalle), l’impact des données alternatives sur l’efficience informationnelle (T. Foucault), les limites de l’IA dans les modèles réglementaires de crédit (C. Hurlin & C. Pérignon) et l’usage des LLMs dans le conseil financier (A. Lo & J. Ross). La partie finale se concentre sur les risques générés par l’IA générative (T. Adrian et al.), les incidents et approches de supervision (C. Balagué), l’état des cadres réglementaires européens et l’AI Act (G. Bagattini et al.), ainsi que la comparaison des régulations dans 49 juridictions (I. Nassr).



