Consolidation périurbaine, déstabilisation rurale et littoralisation des logements en France depuis 2018
Récemment paru, le cahier de recherche Rééquilibrage urbain, déstabilisations rurale et littorale s’appuie sur une étude menée dans le cadre des travaux de la Fondation Cournot soutenus par l’Institut pour la Recherche de la Caisse des Dépôts. Eclairage sur les principaux enseignements de l’étude avec Jean-Philippe Touffut, responsable du Centre Cournot.
Cette étude Quel était l’enjeu de l’étude et pourquoi s’y intéresser ?
Cinq ans après le début de la pandémie, les données accumulées sur les dynamiques résidentielles permettent de faire la part des choses entre les tendances longues et les variations conjoncturelles. Si le rapport entre résidences principales, résidences secondaires et logements vacants paraît stable en France métropolitaine depuis quarante ans, les évolutions sont très contrastées d’une commune à l’autre. L’étude avait pour objectif d’identifier quelques-unes des trajectoires qui se sont dessinées depuis 2019.
Quelle fut la méthode d’analyse ?
Sur la base des données recueillies par l’INSEE, des algorithmes ont été construits pour présenter les variations sous forme de cartes. Sont ainsi illustrées les tendances contradictoires qui touchent les communes de plus de 950 habitants, soit 84 % de la population de l’Hexagone. Les cartes portent sur la répartition des logements entre principaux, secondaires, et vacants et sur l’évolution de leurs surfaces. La méthode a permis d’évaluer l’intensification de la périurbanisation, l’avancée de la littoralisation et la déstabilisation rurale.
Au dynamisme des grandes villes du Sud et de l'Ouest s’oppose le déclin des villes traditionnellement industrielles du nord-est et du centre du pays.
Quels enseignements tirez-vous de ces observations ?
La croissance freinée des résidences principales
Pour l’ensemble des logements, l’augmentation de la surface totale est plus forte que celle de la surface moyenne, c’est le premier constat. La concentration de l'habitat se renforce dans les couronnes des grandes villes et dans les zones périurbaines, où se fait la majorité des constructions sur un foncier rare et cher. La hausse du nombre de logements est ainsi constante, mais elle repose sur une relative stagnation de la surface moyenne des logements neufs.
L'effet démographique soutient la demande pour un plus grand nombre de logements, même si la population totale augmente moins vite. La surface totale est alors sensible à l’effet de "décohabitation" (le nombre moyen de personnes par ménage est en constante diminution depuis trente ans).
Le nombre de résidences principales croît en moyenne de 0,8 % par an depuis 2018. Leur part augmente dans les unités urbaines au détriment des communes rurales. La tendance à la concentration de la population dans les villes se poursuit, mais la proportion des résidences principales diminue lorsque la taille de l'unité urbaine est plus grande. Les grandes unités urbaines (plus de 100.000 habitants, hors Paris) et l'Île-de-France continuent en conséquence de concentrer une part importante des résidences principales, mais leur croissance est freinée par le manque de foncier.
La porosité entre résidences secondaires et logements vacants
Le vieillissement est la première cause de mobilités résidentielles, marquées par l’arrivée renforcée des retraités. La modification de la structure du parc de résidences principales induite par ce phénomène (sous-occupation des logements, problèmes d'accessibilité, flux de biens sur le marché via les successions) n'est pas perceptible sur les cartes. En revanche, l’influence de la population âgée sur la répartition des résidences secondaires et sur la vacance est visible : deux résidences secondaires sur trois sont en effet détenues par un ménage de 60 ans ou plus. Dans certaines régions, le nombre de décès est supérieur au nombre de naissances et l'exode rural se poursuit. Le déséquilibre territorial se renforce : l'augmentation de la vacance est particulièrement marquée dans les zones rurales ou les petites villes en perte de vitesse démographique. Les logements laissés vacants, notamment lors de successions, ne trouvent plus de locataires ni d'acheteurs. La hausse de la vacance s’explique également par la déprise économique, qui agit comme un facteur initial qui déclenche la déprise démographique et la dégradation du bâti. A la mobilité des retraités s’ajoute ainsi le départ des actifs. Le départ des retraités et la déprise économique expliquent la chute de la demande dans des villes moyennes comme Forbach, Nevers, Montceau-les-Mines, Charleville-Mézières ou Saint-Quentin, où la vacance est supérieure à 15% depuis plusieurs années.
Les logements vacants en zones urbaines sont comme les logements ruraux vacants, plus grands en moyenne : inadaptés à la demande (souvent chers, mal isolés, sans équipements sanitaires adéquats), ils nécessitent d'importants travaux de rénovation, pour répondre spécialement aux normes de performance énergétique. Les coûts élevés et la difficulté des démarches peuvent décourager les propriétaires de ces grandes surfaces. Le Diagnostic de performance énergétique (DPE) peut d’ailleurs entraîner l’interdiction de mise en location ou l’interdiction d’augmenter ou d’indexer le loyer. Les logements les plus anciens et les plus grands sont en effet les plus énergivores, notamment les maisons individuelles, surreprésentées parmi les passoires thermiques. Les plus grandes d’entre elles peuvent être l’objet de conversion vers d'autres usages non soumis au DPE locatif : les propriétaires transforment ces logements en résidences secondaires, ce qui maintient la vacance du point de vue de la résidence principale.
Après les grandes villes touristiques, qui comportent le plus grand nombre absolu de résidences secondaires, les communes littorales subissent une secondarisation aussi forte que certaines communes des massifs alpins et pyrénéens. Pourtant, ce mouvement a faibli depuis 2018, il s’est même inversé dans certaines zones. Si les destinations privilégiées des résidences secondaires ont connu un attrait renforcé avec les confinements, et si les prix de l’immobilier y ont augmenté, le nombre des résidences secondaires a baissé en valeur relative.
Comment mesurer les effets des locations meublées temporaires ?
La connaissance de l’évolution du nombre des locations meublées temporaires est donc essentielle, or son estimation, notamment pour la location saisonnière, est difficile. Les données des résidences meublées touristiques disponibles concernent avant tout l’évaluation du volume des offres sur la Toile. L’extraction des données de logements de la base des plateformes à l’échelle d’une commune se fait avec une marge d’erreur importante, car le volume de l’offre est en permanente redéfinition et que les plateformes ne communiquent leurs statistiques qu'à une trop grande échelle.
Au-delà de la fiabilité de l’extraction, le caractère temporaire des offres complique l’analyse. Seuls les hébergements visibles sur le site d’une plateforme à l’instant de la collecte sont téléchargeables.
En dehors des déclarations fiscales, il semble impossible de savoir si un logement mis en location temporaire est une résidence principale louée occasionnellement, une véritable résidence secondaire utilisée une partie de l'année et louée le reste du temps, ou un logement qui a été acheté ou transformé spécifiquement pour la location de courte durée, devenant ainsi une "résidence secondaire commerciale" de fait.
Les cartes illustrent l'impact des locations meublées sur l’évolution des locations dans les grandes villes touristiques, mais elles présentent des corrélations, plutôt que des causalités : la présence d’une plateforme est souvent liée à l'augmentation des prix ou la transformation de logements, mais établir une causalité directe est impossible. Les plateformes peuvent amplifier des tendances déjà existantes plutôt que les créer. Le manque de données granulaires, la complexité du marché immobilier et l'évolution rapide des usages et des réglementations rendent les études délicates, quand elles se fondent sur des modélisations et des estimations qui ne sont pas toujours des mesures directes.
Quels approfondissements pourraient être apportés à ce travail ?
Si le nombre des résidences principales est resté globalement stable, les logements vacants ont donc connu, comme les résidences secondaires, des évolutions très fortes sur certains territoires. Bien que le nombre absolu de résidences secondaires ait augmenté légèrement plus que celui des logements vacants sur cette période, l'enjeu majeur et le plus préoccupant est la hausse continue de ces logements vacants. La vacance des logements, le plus souvent subie, est concentrée dans des zones en déprise démographique, où elle est le signe d'une dévitalisation des territoires. Il serait intéressant de vérifier qu’une vacance stratégique a été mise en place, lorsque son statut est préféré à celui des résidences secondaires et ne répond pas seulement à une demande de villégiature. Ce point mérite à lui seul une étude approfondie.
De même, le phénomène de “réurbanisation”, qui a concerné nombre des ménages qui avaient choisi de déménager au moment des confinements vers des villes petites ou des zones rurales, est mal connu. Combien d’entre eux sont retournés dans les villes moyennes ou les grandes villes ? Les cartes de l’évolution 2018-2024 ne peuvent le montrer, alors que la période 2020-2022 a marqué la plus grande mobilité. Parmi les facteurs de déplacement hors, des villes ou de retour vers les centres urbains, le télétravail a assurément joué un rôle prépondérant et permis les déplacements sur des périodes plus ou moins longues, mais l’impact du télétravail reste difficile à évaluer.
Pour approfondir :
Aller sur le site de l'Institut pour la recherche de la Caisse des Dépôts pour télécharger le rapport final
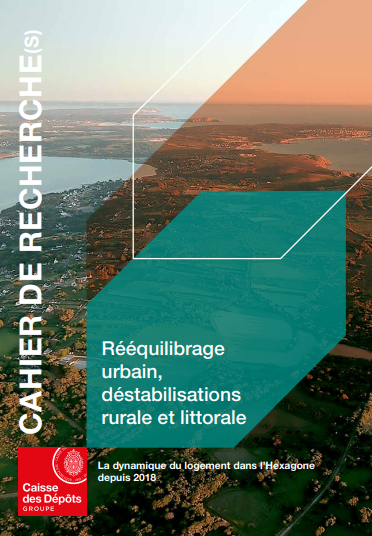
©Agence Eden



